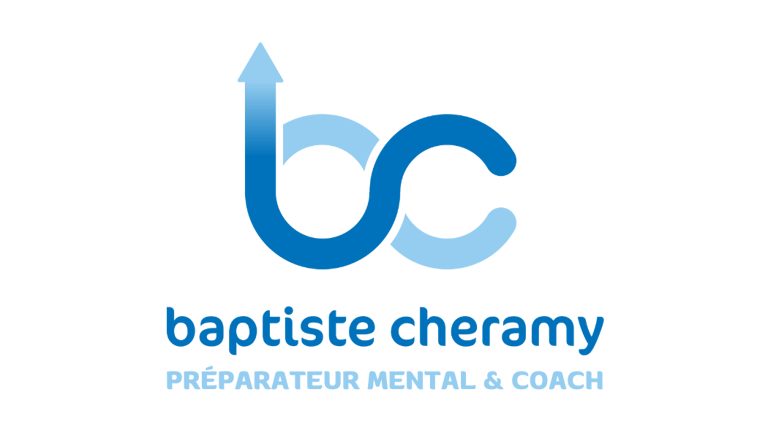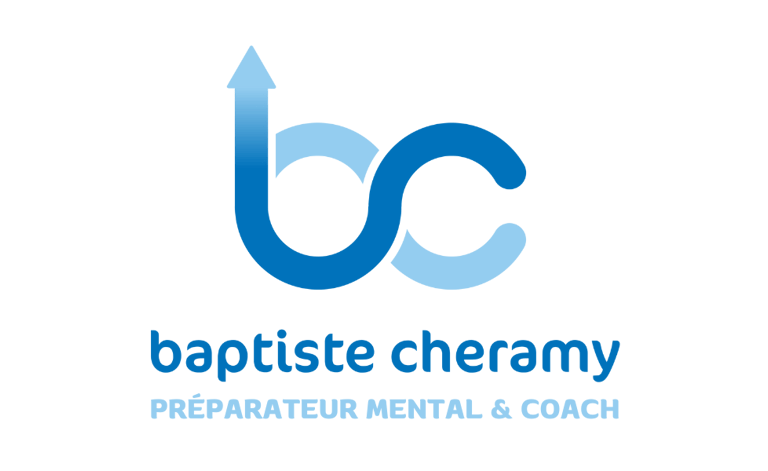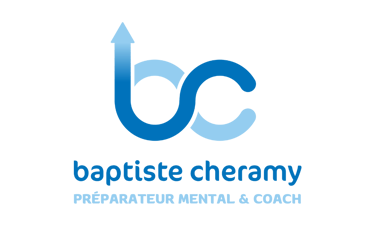Mieux comprendre le déroulement d'un suivi
Voici une étude de cas pour expliquer de manière concrète la forme que prend un suivi en conditions réelles
Baptiste Cheramy, Préparateur mental
5/12/20253 min read


Après avoir expliqué dans un article précédent qu'il existait plusieurs phases dans le déroulement d'un suivi en préparation mentale, je reviens sur le sujet pour y apporter plus de détails avec un cas concret. Dans un souci de confidentialité, la personne que je mentionnerai dans l'exemple cité sera bien évidemment anonymisée.
1. Comprendre la problématique et identifier les besoins
La première étape du suivi est primordiale en préparation mentale. C'est elle qui établit les bases du travail à venir et elle permet aussi et surtout de prendre connaissance, de poser le cadre et de nouer un lien de confiance. Cette phase diagnostic me permet non seulement de comprendre la situation, mais elle a également pour objectif de faire verbaliser l'action à la personne que je suis. En ce qui concerne l'exemple que nous prendrons, la problématique est la suivante. Cette personne décrit être comme submergé par ses émotions et le stress lors de sa pratique, et ce d'autant plus en compétition. Mon objectif ici est d'affiner les questions posées afin d'éclaircir davantage la situation décrite : quelles émotions sont ressenties ? Comment cela se traduit ? Comment décrirais-tu ce stress ? Par la suite, une fois la problématique bien définie, nous cherchons à définir des besoins. En l'occurrence, pour cette personne, il s'agissait de pouvoir se sentir bien de nouveau sur le terrain, mais les besoins auraient pu être très différents, comme apprendre à gérer son stress pour mieux performer sous pression par exemple.
2. Développer des solutions
Comme dans notre cas, les besoins sont clairement orientés vers une recherche de bien-être, il faut en tenir compte. L'objectif pour la deuxième étape du suivi est d'intervenir de manière concrète. Lors de cette phase, l'erreur est de penser que le préparateur mental apporte toutes ses techniques sur un plateau et que la personne suivie n'a qu'à piocher parmi celles-ci. La réalité est tout autre, car le travail est complètement individualisé et chacun aura des besoins différents. Ici, on privilégie la co-construction, c'est-à-dire le fait de trouver des solutions ensemble, de préférence en utilisant les ressources de la personne plutôt que du préparateur mental pour favoriser l'autonomie. Pour revenir à notre exemple, nous nous sommes rendu compte que l'imagerie mentale était une habileté très développée dans son cas et que l'utiliser dans un but de gestion du stress et de ses émotions pouvait s'avérer être une bonne idée. Plus précisément, l'idée était de visualiser un lieu ressource synonyme de calme, de souvenirs agréables et d'apaisement qui pourrait lui servir de zone de confort.
3. En quête de progression
La troisième et dernière étape bilan est un retour permanent de feedbacks entre la réalité du terrain et ce que nous mettons en place. Pour reprendre l'étude de cas, il s'agissait dans un premier temps de prendre des informations à l'entraînement sur ce qui semblait impacter ses émotions. L'imagerie mentale semblait avoir des effets positifs, mais le vrai test était en compétition puisque, pour rappel, c'est dans ces conditions que le stress était le plus important et la gestion de ses émotions la plus difficile. Ainsi, les premiers tests de cette technique ont été utilisés en compétition, et ils s'avéraient concluants. Mais le travail ne s'arrête pas là. Si la méthode fonctionne tant mieux, mais il est alors possible de l'améliorer, d'agir sur les détails pour la perfectionner. Il faut alors comprendre quelles sont les difficultés rencontrées et quels leviers peut-on actionner pour y remédier.